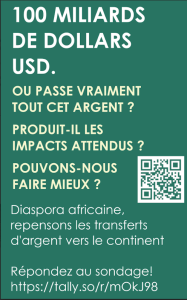Lundi 5 mai 2025, Washington a salué un pas de plus vers la paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. Massad Boulos, conseiller spécial pour l’Afrique à la Maison Blanche, a qualifié les propositions reçues des deux pays d’« étape importante » dans la mise en œuvre de la Déclaration de principes signée le 25 avril dernier sous l’égide des États-Unis.
Mais au-delà de cet optimisme diplomatique, de nombreuses questions demeurent. Où en est réellement ce processus ? Quel est le rôle exact du comité de suivi annoncé ? Et surtout, quels intérêts se cachent derrière l’engagement américain ?
Un comité de suivi encore flou
Le 1er mai, quelques jours après la réunion tenue à Doha à l’initiative des États-Unis, un comité de suivi a été annoncé. Ce mécanisme inclut les États-Unis, le Qatar, la France et le Togo – ce dernier agissant au nom de l’Union africaine. Il est censé accompagner les discussions et la mise en œuvre du processus de paix entre Kigali et Kinshasa.
Cependant, ce comité reste pour l’heure théorique. Aucun calendrier n’a été fixé, aucune réunion programmée, et aucune feuille de route n’a été dévoilée. Son rôle concret, ses responsabilités, et ses modalités d’action demeurent flous.
Un agenda américain sous surveillance
Washington se veut moteur de la paix, mais ses intentions soulèvent des doutes. Certains partenaires pointent une diplomatie trop centrée sur la défense des intérêts américains. D’ailleurs, la déclaration de principes du 25 avril souligne déjà que ce processus vise aussi à
« protéger les intérêts stratégiques des États-Unis dans les minerais critiques ».
Cette dimension économique, notamment liée aux ressources de l’Est congolais (cobalt, coltan, etc.), alimente les interrogations sur la sincérité du processus. La réorganisation actuelle de la diplomatie américaine en Afrique complexifie également la lisibilité des rôles de chacun dans ce dossier sensible.
Et maintenant ?
Une nouvelle rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda est envisagée dans les trois prochaines semaines. Mais aucune date n’a encore été confirmée. De leur côté, la France, le Qatar et le Togo attendent désormais de Washington plus de clarté sur la suite du processus, tant sur le fond que sur la forme.
Si la paix semble sur la table, elle reste encore suspendue à des engagements concrets. Et aux intentions réelles des puissances qui s’en font les garantes.